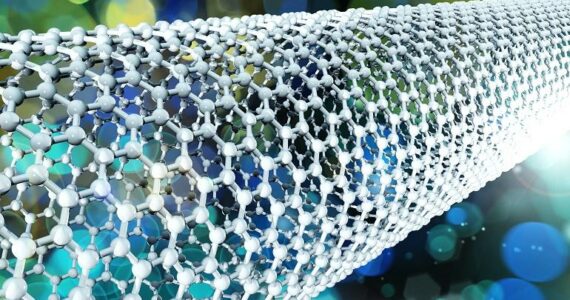Inspiration, appréciation, appropriation…Les emprunts à des cultures dans le monde de la mode sont une constante, et dans une société où les identités sont de plus en plus fragmentées, le débat sur la notion d’appropriation culturelle, autrefois marginal, est désormais public.
Le port d’une coiffe amérindienne en 2012 lors du défilé Victoria’s Secret, les dreadlocks des mannequins chez Marc Jacobs dans sa collection Printemps-Ete 2017, les turbans inspirés de la culture Sikh chez Gucci à l’Automne 2018, la liste de marques ayant pu tomber dans le piège de l’appropriation culturelle est longue, et a entaché bien des réputations.
Voici quelques pistes de réflexions sur une notion complexe, et qui soulève bien des questionnements dans le domaine de la mode et du textile.
Une définition complexe
L’expression d’appropriation culturelle se diffuse en France à partir de 2010, et il est désormais difficile d’ignorer ce qu’est une appropriation, dont la définition reste pourtant complexe. La notion serait apparue dans les années 90 au Canada dans les milieux autochtones intellectuels, et a donné lieu à des travaux scientifiques, mais aussi à une grande variété d’articles dans la presse française et étrangère.
L’appropriation culturelle supposent des rapports de domination, et d’oppression. Ceux qui s’estiment spoliés sont associés à des dominés, ceux qui spolient sont donc les dominants. Pour l’ethnologue Monique Jeudy-Ballini, le concept d’appropriation culturelle est tout d’abord l’héritage du courant académique postcolonial des années 80. Ses tenants dénoncent l’usage par «des membres de la société dominante occidentale des biens matériels et immatériels issus de pays anciennement colonisés ou de minorités historiquement opprimées», à l’instar des Afro-américains ou des Amérindiens. «En ce sens, les appropriations culturelles assimilées à des spoliations passent pour une forme de néocolonialisme», précise la chercheuse au CNRS.
La notion s’est développée dans le sillage de deux mouvements. Tout d’abord, l’émergence des études post-coloniales à la fin des années 70 portées par des figures intellectuelles importantes telles que Edward Saïd, Helene Cixous, ou bell hooks. Ensuite dans les années 80, les revendications de peuples autochtones, notamment aux Etats-Unis, au Canada ou en Australie mettent en lumière les spoliations, tant matérielles que culturelles dont ils font l’objet.
La mode dans le viseur
Le domaine de la mode et de l’habillement est régulièrement pointée du doigt pour des faits d’appropriation culturelle. Par exemple, lors du défilé Printemps Été 2016 du créateur Junya Watanabe, la collection a pour thème « African » et tandis que les mannequins défilent avec des dreadlocks, des tresses collées, des cols Massai ou encore les cicatrices traditionnelles des Karamojongs d’Ouganda, force est-il de constater qu’ils sont blancs et donc portent des attributs vestimentaires et esthétiques qui ne sont a priori pas les leurs.
De même en 2017, Chanel est accusé d’appropriation culturelle après avoir fabriqué et commercialisé un boomerang siglé, inspiré de l’artisanat des cultures aborigènes d’Australie, et commercialisé au prix de 2000 euros.
Au regard de l’industrie qui nous intéresse ici, on peut donc circonscrire l’appropriation culturelle à plusieurs éléments. Tout d’abord, le fait d’endosser des vêtements, des coiffes, des styles de coiffure qui sont tenus pour des marqueurs de l’identité ethnique de ceux qui les ont produits. Ensuite, le fait de s’emparer à des fins artistiques de l’histoire d’une oppression même lorsqu’on est étranger à ce peuple. Enfin, le fait de faire du profit sur la commercialisation de cette forme artistique, esthétique, artisanale.
La langage des appropriations culturelles devient alors le langage type pour exprimer des formes de spoliation, le sentiment d’être discriminé, spolié économiquement, qui va sortir des cadres habituels de l’exploitation coloniale. Si les castings se diversifient en terme de représentations, de carnations, et de morphologie, les questions de décolonisation, de néo-colonialisme et de diversité demeurent.
Inspiration, « appréciation, » appropriation : le cas du streetwear
L’exemple du streetwear au regard de la notion est assez frappant. Regardant sa définition, le mot « street » (rue) utilisé avec un autre mot tel que « wear » (porter, vêtement) ou « culture » est actuellement utilisé par tellement de gens et d’institutions différentes, pour désigner des choses tout aussi différentes, que durant deux décennies il a été quasiment impossible de trouver une définition unique appropriée. Chacun semble s’accorder à dire que le streetwear est au coeur d’une subculture urbaine intensément indépendante. Steven Vogel, journaliste et auteur de l’ouvrage Streetwear, décrit ainsi le phénomène. Durant les 30 dernières années il a été une des expressions de la culture street la plus visible et la plus rapidement acceptée de manière générale. De la constante aliénation et frustration ressentie par des enfants des quartiers défavorisés, notamment à New York mais partout dans le monde, une communauté a émergé, influencée par le skateboard, le punk, le hardcore, le reggae, le hip hop, la scène club émergente, le graffiti, les voyages et la scène artistique des zones du centre des villes américaines – autant de subcultures, qui ont alimenté la scène artistique américaine et occidentale par la suite. Ces cultures ont pris place dans des villes – leur valant la dénomination d’urban cultures, de cultures urbaines. Elles s’inscrivent dans un rapport à la ville et à la rue (la street), où s’y sont forgés un mode de vie, une esthétique, un style, une mode : le streetwear.
Pourtant le terme semble désigner aujourd’hui un style vestimentaire plus qu’un mode de vie, alors qu’initialement il incarne la réalité d’une classe sociale ségréguée. Aussi la diffusion de cette culture à laquelle est rattaché certes un style vestimentaire, mais aussi une panoplie de références musicales, artistiques, cinématographiques, pose le problème de l’esthétisation de la précarité et a fortiori de la douleur – un topos qu’on peut faire remonter à la Renaissance, si on repense aux oeuvres du Caravage qui subliment la pauvreté et les physionomies d’indigents.
D’un point de vue de l’habillement, le streetwear est caractérisé par son aspect pratique, confortable et est constitué principalement de pièces sportives produites en grande quantité par des marques telles qu’Adidas, Nike, Puma, Converse, Supreme entre autres. A ces vêtements s’ajoutent des accessoires : sneakers, bijoux, casquettes, maroquinerie luxueuse. Ces objets ont tout d’abord été produits pour des sportifs et portés par ces derniers, puis appropriés et popularisés par des artistes issus notamment des communautés afro-américaines des ghettos étasuniens, qu’ils soient graffeurs, danseurs ou rappeurs. Par exemple, le groupe de hip hop Run-D.M.C devient partenaire de la marque Adidas, arborant à chaque concert le modèle de baskets Superstar produit par la marque. Mais il est difficile d’affirmer que le streetwear est le style d’une classe sociale. Ces objets sont en effet passés progressivement dans le vestiaire de la mode contemporaine et ce qu’on ne voyait jusque là que sur les terrains de sport ou dans les banlieues se retrouve aux abords des sorties de défilés de la fashion week, sur les podiums, dans les magazines spécialisés, sous des termes tels qu’athleisure ou sportcore.
De nouveau mécanismes de création
Alors qu’historiquement jusque là les classes populaires étaient dans la constante imitation du style des élites (phénomène de trickle up), désormais, les classes dominantes copient les classes populaires (phénomène de trickle down). Sans pour autant justifier du même vécu, ou des mêmes identités, souvent plurielles : aussi le streetwear incarne particulièrement bien ce nouveau mécanisme de création et de production.
Ce style des classes populaires, au lieu d’être rejeté comme il aurait pu l’être auparavant est donc ingéré par toutes les classes sociales, est importé d’une part par des individus issus de classes populaires, par exemple Kanye West avec sa marque Yeezy et ses collaborations avec Adidas aux Etats Unis, mais est d’autre part véhiculé par des institutions traditionnellement associées aux classes supérieures – notamment les grandes maisons de couture ou les créateurs de prêt à porter de luxe, qui prétendent s’en inspirer.

Le débat n’a cependant rien de nouveau. La récupération de la culture street par les marques de luxe n’est pas neuve. À la fin des années 70, le couple de stylistes Marithé et François Girbaud produit en 1981 un baggy, et en 1985 affiche l’« African waistline», laissant déborder le caleçon. La marque élève alors le streetwear dans les rangs du prêt-à-porter de luxe et fait descendre, dans un même souffle, la mode des podiums dans la rue.
En 1986, pour sa collection «Constructiviste », Jean-Paul Gaultier habille ses modèles de bonnets de rappeurs en lycra à bande élastiquée, tandis que cinq ans plus tard Chanel propose des accessoires « street » tels que casquettes à l’envers et répliques de bobs Kangol, colliers à gros maillons dorés portés en grappe, pendentifs-plaques et sneakers. Plus que de simples accessoires, ce sont des symboles, un imaginaire collectif qui sont exergue ici, d’autant plus qu’ils sont attachés à une culture dont certains éléments régulièrement méprisés, tandis que d’autres aspects sont galvanisés, esthétiquement appréciés et sont par conséquent l’objet d’appropriation.
Quels sont les reproches formulés à l’adresse de ces créateurs ?
Le principal problème soulevés par les communautés spoliés et leurs alliés est tout d’abord celui de s’approprier un style vestimentaire, d’imiter un lifestyle, sans pour autant en subir les désavantages liés à l’identité à laquelle ils sont associés. Et même si l’ « appréciation « pour ces cultures est sincère, elle pose problème car en capitalisant sur l’esthétique construite d’une identité, ces acteurs du secteur de la mode et de l’habillement profitent d’une situation d’oppression matérielle, économique, et surtout culturelle réelle, qui n’est que renforcé. Les termes de citation, inspiration ou d’ « appréciation » culturelle, s’ils reviennent souvent sont donc écartés par ces aspects économiques et financiers qui ne bénéficient pas aux spoliés.
Plus que des reproches, ce sont des questions que suscitent ce genre de phénomènes. En effet ces cultures souhaitent-elles réellement être récupérées par la mode ? Est-il possible de détacher un vêtement de son contexte culturel ? Peut-on réellement capitaliser sur une subculture, qu’elle soit punk, street, ou bien issue d’une communauté minoritaire sur un territoire donné ?
Le vêtement représente en ces cas plus qu’un simple apparat mais est un marqueur fort de l’identité, ou des identités d’un individus, notamment lorsqu’ils sont issus ou font partie intégrante d’une subculture.
Pour le sociologue anglais Dick Hebdige, fondateurs des cultural studies, une subculture est un ensemble significatif de pratiques et de représentations qui distinguent un groupe d’individus d’un autre. Aussi, elle est composée de plusieurs facettes : des vêtements identifiables et de goûts musicaux spécifiques, ainsi que des convictions politiques plus ou moins structurées et un langage, un vocabulaire et une expression qui lui est propre. C’est ce que Hebdige appelle l’« homologie » entre les différentes composantes d’une sous-culture. Dans le cas des punks, il explique :
« La sous-culture punk confirme clairement cette thèse. Sa cohérence est indéniable. Il y a un rapport d’homologie évident entre les vêtements trash, les crêtes, le pogo, les amphétamines, les crachats, les vomissements, le format des fanzines, les poses insurrectionnelles et la musique frénétique et “sans âme”. Le répertoire vestimentaire des punks était l’équivalent stylistique d’un jargon obscène et, de ce fait, ils parlaient comme ils s’habillaient « .
Le même constat est vrai pour la subculture urbaine : pour un style vestimentaire, on retrouve une identité de classe, de race, une musique (le hip-hop et le rap principalement), un vocabulaire. Donc si à l’instar du punk le vocabulaire stylistique street passe dans le vestiaire usuel, l’identité qui y est initialement associée est mise de côté, mais aussi détournée.
Entre emprunt et appropriation, difficile de placer le curseur…
Finalement on pourrait considérer que la notion d’appropriation culturelle envisage la culture comme un ensemble de biens matériels ou immatériels, quelque chose qui semblerait figé. Or, une culture est par définition vivante, elle s’entretient, elle vit par les échanges, les apports à son milieu. En effet ce qui semble inspirer les créateurs c’est l’esthétique du mouvement plus que ses origines profondes. Avec l’idée de streetwear c’est avant tout l’idée d’un confort, mais aussi la nostalgie d’une époque, où l’esthétique particulière des clips de hip-hop, entre richesse ostentatoire et pauvreté fardée, marquait une génération entière.
Il est souvent difficile de placer le curseur entre l’emprunt à une culture et l’appropriation culturelle – et c’est là où les rapports de domination et la conscience de leur existence prennent toute leur importance. L’histoire des cultures, notamment dans un contexte post-colonial est difficile à ignorer.
La « citation », ou l’ « appréciation » sont des notions trop vagues pour être appliquées pratiquement dans le processus de création, et une simple phrase dans un communiqué de presse ne suffit pas à justifier de l’usage de certains attributs propres à une culture, une religion, une communauté. Outre l’identité des créateurs ou des marques, les tactiques de communication et les biais de représentation sont importants. Faire appel à des mannequins, des photographes, vidéastes, artistes issus des cultures concernées est déjà une première étape vers une création plus consciente des rapports de domination inhérents à notre société.
-14/03/19-